Profitons de la chronique du Sable était rouge (dans notre dossier La guerre au cinéma du numéro –27 de CUT, sorti ces jours-ci) pour faire un petit retour sur la carrière de son passionnant acteur-réalisateur, l’oublié et précurseur Cornel Wilde.
Grand (1m85), bâti comme une armoire normande, brillant (il parle six langues), ce sportif accompli (il est champion d’escrime) est né en Hongrie en 1915. D’abord attiré par la médecine, il interrompt finalement ses études pour se tourner vers le théâtre. Repéré par Laurence Olivier, à qui il apprenait le maniement de l’épée, il débute jeune sur les planches avant d’être appelé à Hollywood dès le début des années 40. S’illustrant dans des genres différents, il est quand même naturellement porté vers le polar et les rôles d’action où son physique imposant et ses qualités athlétiques font merveille. Le cinéphile se souvient de lui dans Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille – où il partage la vedette avec Charlton Heston – ou dans Association criminelle (The big combo – 1955) de Joseph H. Lewis.
Désireux de s’investir davantage dans les projets où il apparaît, Wilde passe à la réalisation au milieu des années 50 et va tourner – sur une période de 20 ans – huit films qu’il produit également et scénarise même parfois. Cela donnera au départ Le virage du diable (1957), bande plutôt anecdotique sur le milieu des courses de voitures, ou Tueurs de feux à Maracaibo (1958), un sympathique petit film d’aventures tournant autour des pompiers chargés d’éteindre les puits de pétrole en feu.
C’est à partir de son œuvre suivante, Lancelot, chevalier de la reine (1963) qu’il commence à montrer une réelle ambition de cinéaste. Il s’y octroie le rôle de Lancelot – qu’il interprète en empruntant un accent français proprement irrésistible – et donne à sa femme Jean Wallace (présente dans tous ses films) celui de Guenièvre. Si le film n’est pas encore débarrassé de quelques aspects hollywoodien un rien attendu (que Wilde évacuera de ses projets suivants), il frappe malgré tout par le dynamisme de ses scènes d’action ainsi que par sa violence, surprenante pour l’époque. C’est trois ans plus tard qu’il tourne son long-métrage le plus fameux, La proie nue, qui force instantanément la critique à le prendre au sérieux.
Le film conte la fuite éperdue à travers la brousse d’un aventurier poursuivi par une tribu en colère, dans l’Afrique des années 1860. Le style est brut, les dialogues presque inexistants, la psychologie des personnages réduite aux plus élémentaires instincts et les barbarismes de la mise en scène côtoient un regard critique sur les dégâts causés par l’homme blanc sur le continent africain (safaris meurtriers, esclavagisme…). Un cinéma que l’on ne qualifiera pas de primaire, mais de primitif – au sens noble du terme. La musique, entièrement constituée de percussions et de chants africains (rythmant à merveille les courses-poursuites), la beauté des images et les moments contemplatifs où le cinéaste s’attarde sur la nature et les animaux confèrent à l’ensemble un ton assez insolite. La vitalité des scènes de traque et le sadisme des moments de violence évoquent par ailleurs plus d’une fois le Apocalypto de Mel Gibson. Pour l’anecdote, le fait divers à l’origine de La proie nue est en réalité arrivé aux États-Unis et concernait un pionnier poursuivi par des Amérindiens. La délocalisation s’adapte heureusement parfaitement au continent africain.
Suivront en 1967 l’un des plus anti-guerre des films de guerre, Le sable était rouge, sur lequel nous ne nous étendrons plus et en 1970, Terre brûlée, unique réalisation du cinéaste dont il ne tient pas lui-même la vedette. Dans ce film de science-fiction écologique et pessimiste, l’Angleterre est décimée par un virus détruisant herbe et cultures. Un petit groupe de survivants tente d’y rallier un Eldorado improbable, mais la famine règne et les routes sont livrées aux pilleurs. Violent, extrêmement sombre (le film fait preuve d’un manque de foi envers la race humaine qui fait froid dans le dos), Terre brûlée ne jouit pas de la notoriété d’un Soleil vert (qu’il ne vaut, il est vrai, sans doute pas), mais s’avère tout à fait passionnant et anticipe de quasiment dix ans la vogue de film post-apocalyptique lancée par le Mad Max de George Miller.
Cornel Wilde ne réalisera plus qu’un film par la suite, Les requins (1975), récit d’aventures mineur et ne tournera presque plus en tant qu’acteur. Il sera emporté par une leucémie en 1989. S’il a été un réalisateur peu prolifique et reste de nos jours tenu dans une relative confidentialité, l’intérêt – artistique et historique – de son œuvre est indéniable. S’il avait davantage tourné, peut-être bénéficierait-il à l’heure actuelle d’une reconnaissance égale à celle d’un Clint Eastwood…
Il n’est pas toujours chose facile de voir ses films aujourd’hui. Terre brûlée a été diffusé il y a quelques années au ciné-club de France 3 et Lancelot, chevalier de la reine à été aperçu – il y a un certain temps aussi – sur une chaîne câblée. En DVD zone 1, Le sable était rouge (Beach red), est disponible chez MGM (en vostf) et La proie nue (The naked prey) chez Criterion (sans sous-titres, mais le film est quasiment muet). D’autres de ses œuvres ont été disponibles en VHS il y a très longtemps. On attend encore qu’un éditeur DVD veuille bien s’intéresser sérieusement à son cas en France…
Mathias Ulrich



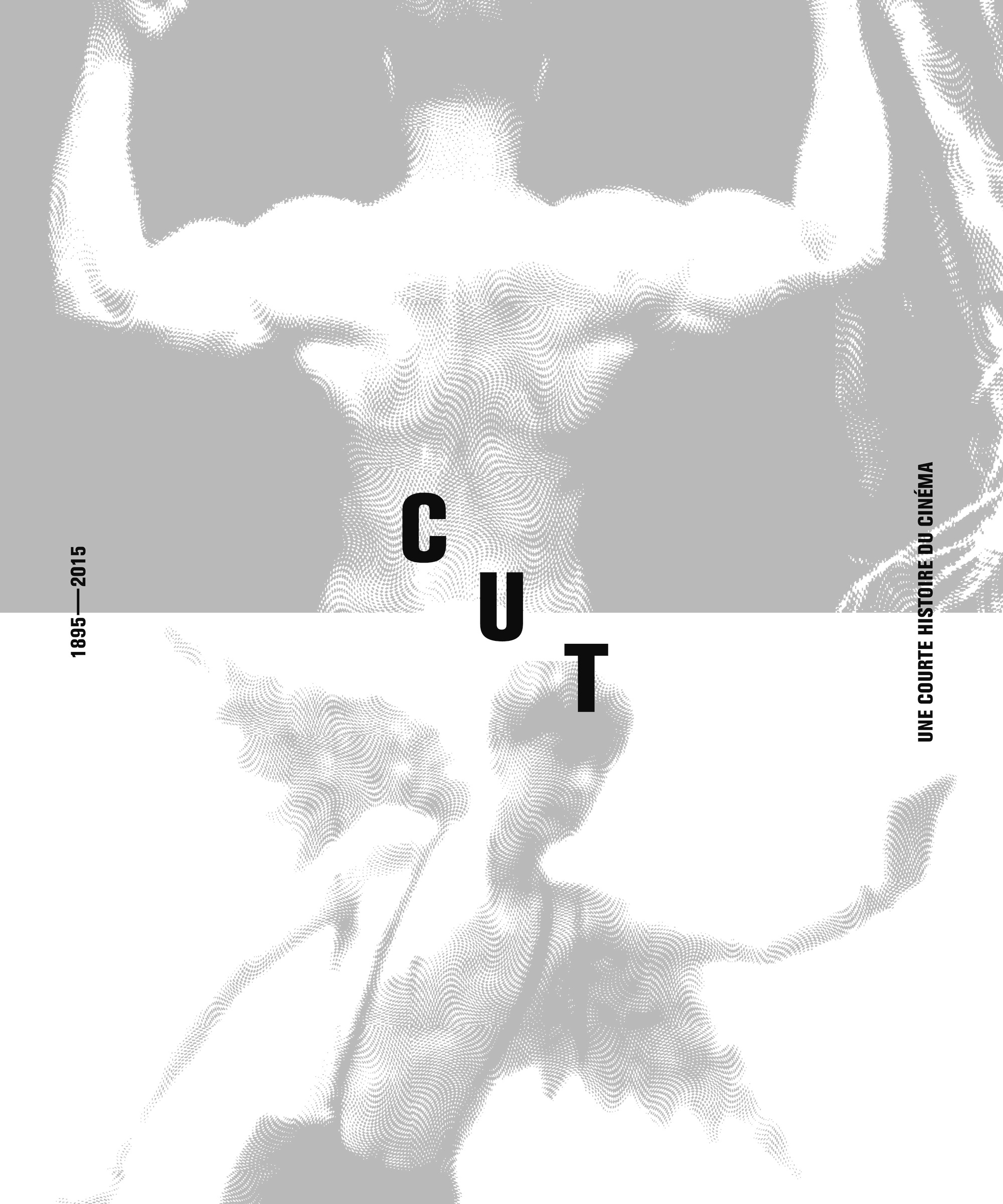



Passionnant cet article ! Ca donne envie !
merci Mathias !
Tu vas me faire rougir.
Comme les sables ?
arf arf arf