A ne pas manquer, un événement Star Saint-Exupéry / Horreur c’est vendredi / CUT : vendredi 25 avril à partir de 20h au Cinéma Star Saint-Exupéry (18 rue du 22 novembre à Strasbourg) une soirée spéciale Philippe Nahon, et en sa présence s’il vous plait! Deux films (interdits aux moins de 16 ans) dans lesquels il excelle seront projetés : Calvaire de Fabrice du Welz suivi de Seul contre tous de Gaspar Noé. Et entre les deux, une rencontre public avec Philippe Nahon.
A cette occasion, voici le portrait qui lui a été consacré dans le livre « Portraits: acteurs du cinéma français » (Ed. Arthénon).
Par Romain Sublon (texte) et Stéphane Louis (photo)

LA GUEULE DE L’EMPLOI
« Pour tout bagage on a vingt ans / On a l’expérience des parents / On se fout du tiers comme du quart / On prend l’bonheur toujours en retard (…) Pour tout bagage on a sa gueule / Quand elle est bath ça va tout seul / Quand elle est moche on s’habitue / On s’dit qu’on est pas mal foutu / On bat son destin comme les brêmes / On touche à tout on dit: « Je t’aime » / Qu’on soit d’la Balance ou du Lion / On s’en balance on est des lions. » (paroles extraites de 20 ans). Cette chanson, Léo Ferré l’a écrite en 1960. En 1960, Philippe Nahon avait vingt-deux ans pour tout bagage, et l’expérience de ses parents. Une chanson qui fait écho à la vie du bonhomme.
« A l’école, on te demandait de réciter ta poésie et toi tu faisais : badaba / badaba / badaba. Moi, grâce à mon père, j’y mettais mon âme. Puis il m’emmenait au théâtre et on jouait Cyrano de Bergerac à la maison. Un soir, je lui ai dit : Papa, plus tard, je serai sur scène. Il m’a répondu : t’es fou. » Son père avait vu juste, Philippe Nahon est un peu fou. Quand il décide de quitter l’école, c’est pour jouer au théâtre. « Je n’ai ni le BAC ni le Certificat d’études, sur mon carnet militaire est écrit : L.E.C pour lire, écrire, compter. » A 20 ans, il joue ses deux premiers spectacles pros, mais il doit s’arrêter. Et partir pour la guerre d’Algérie.
Philippe Nahon est un peu fou. « Là-bas, en Algérie, j’ai monté un spectacle de fin d’année. J’avais demandé une exemption de service de 10 jours, pour moi et mes collègues. On l’a fait et sur scène, je me suis payé le culot de chanter devant tout le monde Le déserteur, a capella. » Sur le coup, ses supérieurs ont bien réagi. « Et dès le lendemain, on s’est retrouvé en cabane pour des conneries.» Philippe Nahon n’est pas rentré intact de cette sale guerre. On ne rentre pas intact d’une guerre. « Ma mère ne m’a plus vu rire pendant six mois… J’aimerais jouer dans un film qui traite de la guerre d’Algérie, aussi pour exorciser ce que j’ai pu vivre là-bas. »
A son retour d’Algérie, Philippe Nahon rencontre Jean-Pierre Melville, qui lui offrira son premier rôle au Cinéma (Le Doulos, 1962). Pas tout à fait le fruit du hasard, « mon père avait des copains proches de Melville. » Le jeune Nahon attendra huit ans avant de jouer dans un deuxième film (Les camisards, 1970). Entre-temps, il sillone la France avec ses potes, dans une vieille camionnette, et joue devant tous les publics. Entre-temps, son père meurt. « J’aimerai qu’il soit encore là… », souffle-t-il.
Alors, plus que jamais, il met de l’âme dans les textes qu’il récite. Avec la force d’un lion. Cette force qui lui a permis de porter sur ses épaules LE personnage de sa vie : celui du boucher, d’abord dans Carne (1991), puis dans Seul contre tous (1998) de Gaspar Noé. « Gaspar m’a repéré en voyant ma photo au fichier éléctronique du spectacle !»
Ce personnage de franchouillard, haineux, vicieux et rance (si humain qu’il est celui qui nous côtoie au quotidien), Philippe Nahon l’a incarné jusqu’à faire corps avec lui. Mais il sait, depuis sa toute petite enfance, ce que le mot jeu veut dire. « Moi quand on dit coupé, c’est fini. Heureusement que je suis sorti de ce rôle ! Ca fait presque 10 ans et tout le monde continue de m’en parler…»
Personne n’a oublié. Depuis, Philippe Nahon a la gueule de cet emploi : les tordus, les vilains, les marlous, c’est souvent pour lui. « Ca m’étonne, surtout des jeunes réalisateurs, qu’ils n’aient pas plus d’audace. » Il enchaîne : « certains réalisateurs te voient barbu, ils ne t’imaginent pas imberbe, ils te voient imberbe, ils ne t’imaginent pas barbu. Quand t’es comédien, tu peux tout faire bordel ! Moi, je n’ai jamais tué personne avec une scie comme dans Haute tension. Si j’avais eu la vie de mes rôles, faudrait qu’on m’enferme. » On est toujours un peu prisonnier de sa gueule.
A bientôt 70 ans, Philippe Nahon n’est pas fatigué, loin de là. Il a toujours en lui cette furieuse envie de jouer, mais pas à n’importe quel prix. « Je ne veux pas servir la soupe. Luc Besson m’avait proposé quatre répliques dans Angel-A. J’ai refusé. Je veux bien accepter des petits rôles, mais qui peuvent se défendre. »
Des rôles dans lesquels Philippe Nahon peut jeter son âme. Comme à l’école, quand il récitait ses poèmes.
MINIBIO
Né le 24 décembre 1938 à Paris (France). Philippe Nahon a découvert la poésie, l’amour des textes et du théâtre grâce à son père. En 1991, il rencontre Gaspar Noé cinéaste avec lequel il tournera Carne et Seul contre tous, ses deux films majeurs. Acteur aimé des jeunes cinéastes, il multiplie les premiers films. Investi dans chacun de ses rôles, Philippe Nahon est capable de tout. Il a joué dans plus de 40 films, et l’on n’est pas au bout de nos peines !
Filmographie sélective : Le Doulos (Jean-Pierre Melville, 1962), Seul contre tous (Gaspar Noé, 1999), Calvaire (Fabrice du Welz, 2004), Virgil (Mabrouk El-Mechri, 2005), Vendredi ou un autre jour (Yvan Le Moine, 2006), MR 73 (Olivier Marchal, 2008).
 Portraits : acteurs du cinéma français (Editions Arthénon) 35 euros. Disponible en librairie.
Portraits : acteurs du cinéma français (Editions Arthénon) 35 euros. Disponible en librairie.













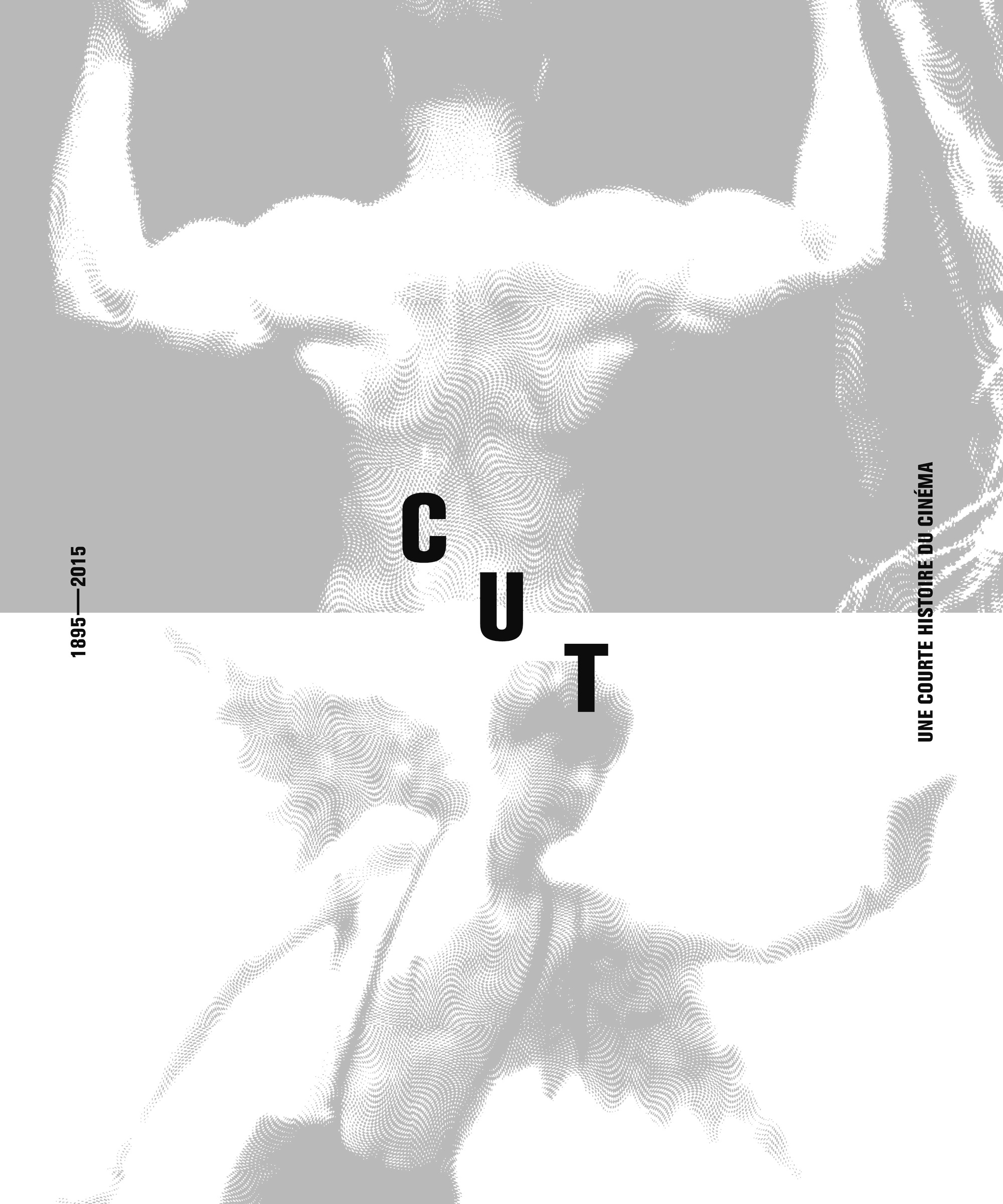



Commentaires récents