
Ed. Carlotta
L’éditeur l’annonce fièrement, il s’agit d’une exclusivité mondiale. Pour la première fois ces quatre films, pièces maîtresses de la carrière du cinéaste Frank Borzage, sont réunis en coffret DVD –aussi disponibles en Blu-ray. Comme souvent Carlotta use légitimement d’effets d’annonce qui ailleurs paraîtraient creusement tapageurs : Frank Borzage, à la fin de l’ère richissime du cinéma muet était bien (et demeure post mortem) « un maître du cinéma hollywoodien ! ».
Avec mon camarade FX, nous nous faisions récemment la réflexion qu’il y aurait des choses passionnantes à découvrir du côté du cinéma muet made in USA, mais que les studios hollywoodiens ne se préoccupent pas beaucoup de valoriser leur catalogue dans ce domaine. Fait-on mieux en Europe, en Russie ? On peut le penser…
Quoi qu’il en soit, c’est un Suisse, Hervé Dumont, qui supervise l’édition de ces quatre films longtemps considérés comme perdus à jamais alors qu’ils étaient simplement mal rangés. Petits bouts par petits bouts retrouvés, ils ont ainsi pu être reconstitués au mieux et c’est impeccable en ce qui concerne L’heure suprême, L’ange de la rue et Lucky star. En revanche pour La femme au corbeau il manque pas mal de métrage, mais les bobines restantes et le commentaire audio de Dumont, qui s’appuie aussi sur des photos de tournage, justifient amplement la place de ce petit bijou sur un DVD !
C’est d’ailleurs par La femme au corbeau (1928/1929) que j’ai commencé mon visionnage parce qu’en feuilletant les trois livrets accompagnant les DVD, je suis tombée en arrêt devant cette photo d’un avenant jeune homme se hissant nu, TOUT NU, sur un bord de rivière d’où une jeune femme habillée l’observe avec amusement. Coquin-coquin : le vilain sénateur Hays n’était pas encore passé par là avec son code « moral ». Mais c’est une autre scène, encore plus osée, qui a fait la réputation de ce film… L’histoire est celle d’un jeune homme naïf (Charles Farrell) qui tombe amoureux d’une jeune femme aguerrie (Mary Duncan) dans un coin de montagne isolé. Elle se joue de lui, il fait bonne figure, mais, à la fin, il craque et va se perdre dans la neige où il gèle : vient alors LA scène d’anthologie où la femme l’allonge nu dans son lit et se couche sur lui pour le réchauffer. Là ce n’est plus coquin, c’est franchement érotique. Sur le même DVD, il y a une autre pépite, Lucky Star, où l’on retrouve le géant Farrell face à la minuscule Janet Gaynor, sa partenaire la plus régulière (un duo inventé par Borzage dans L’heure suprême). Il s’agit là encore d’un film qui se déroule dans un coin reculé des USA : Gaynor incarne une pauvresse insolente et âpre au gain, Farrell lui colle une fessée à leur première rencontre parce qu’elle a exagéré, alors elle le mord ce qui lui vaut cette réplique scandalisée : « Tu n’es qu’une cannibale ! ». Puis Farrell part à la guerre (ça se passe en 1917) et revient dans un fauteuil roulant. Gaynor cherche d’abord à l’arnaquer, surtaxant les produits qu’elle lui vend en arguant du fait que certes c’est moins cher ailleurs, mais qu’il faut des jambes pour y aller (et toc). Puis peu à peu les choses s’arrangent entre ces deux-là qui ont beaucoup à s’apporter. Drôle, vif, inventif, beau… C’est BEAU.
Les deux autres DVD contiennent respectivement L’heure suprême (1927) et L’ange de la rue (1928), deux films ayant beaucoup de points communs : ils se passent en Europe (la France pour le premier, l’Italie pour le second) et sont interprétés par Janet Gaynor et Charles Farrell, pauvres parmi les pauvres qui tentent de se créer une vie commune malgré les obstacles. On dit de Borzage qu’il fait des mélodrames, mais ces deux films, apparentés au genre, sont loin d’avoir les côtés excessifs, dégoulinants, ridicules ou larmoyants qui entachent le genre (pour les non amateurs s’entend) : au contraire on rit souvent, les personnages ont des réactions surprenantes que la sobre direction d’acteur accentue, la mise en scène est élégante, créative, les décors –tout en studio- sont impressionnants, le récit prenant… Bref, c’est la classe ! D’ailleurs, apprend-t-on, L’heure suprême a valu à Frank Borzage le tout premier Oscar du meilleur réalisateur de l’histoire des Oscars. Ce n’est pas toujours un gage de qualité, mais là si.
Chacun de ces disques est complété par des analyses et des contextualisations intéressantes, le plus souvent signées Hervé Dumont. Et puis il y a aussi trois épisodes tournés par Borzage pour une série TV intitulée Screen directors playhouse : est-ce le format télé ou le passage au parlant (je suis une ignare, Borzage a une longue carrière très fournie aussi bien du temps du muet que du parlant, mais je n’avais jamais rien vu de lui et je n’ai donc aucun élément de comparaison auquel me raccrocher), toujours est-il que ces courtes histoires semblent bien édifiantes, bien lourdingues… En y regardant de plus près elles sont un peu plus subtiles qu’il n’y paraît, mais on est loin de l’état de grâce éprouvé devant les films. Car ces films, ahlala !!!
Voir la fiche du coffret et des extraits des films sur le site de Carlotta.
Jenny Ulrich









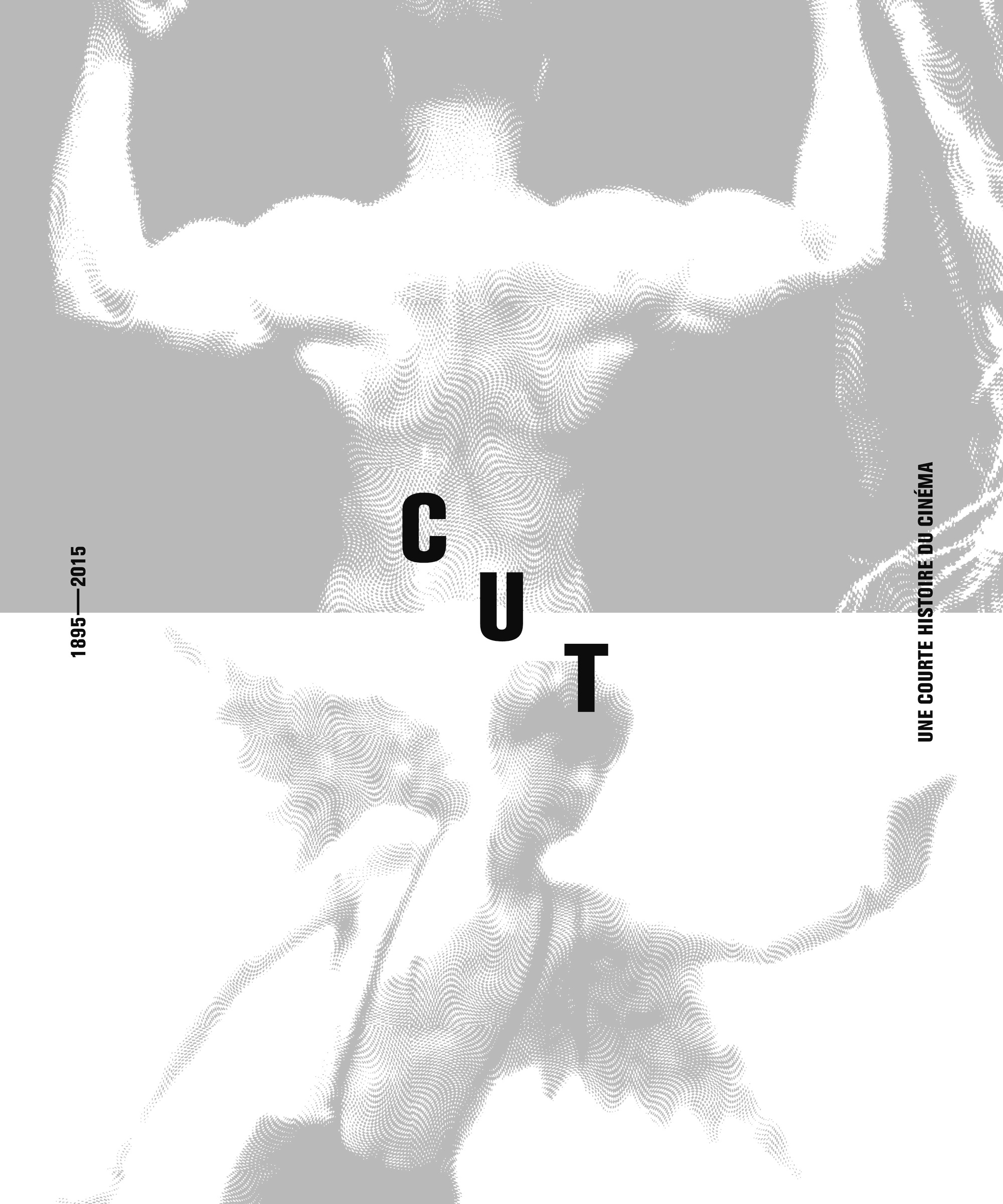



Commentaires récents