
Ed. Capricci
Après la belle édition en livre-disque de Honor de cavalleria, Capricci récidive en sortant la nouvelle fantaisie du cinéaste espagnol, Le chant des oiseaux.
A sa manière très particulière, le réalisateur suit le parcours des rois mages venus présenter leurs dons à l’enfant Jésus. Dans un noir et blanc somptueux et d’interminables plans de nature à faire pâlir de jalousie les Straub, le metteur en scène malicieux filme les déambulations de trois personnages indolents et indécis. De déserts de sable en déserts de glace, ces trois figures burlesques, aux discussions souvent prosaïques, provoquent une certaine incompréhension avant d’emporter l’adhésion.
Leurs hésitantes tribulations, la façon dont Serra leur fait, lentement, très lentement, traverser le cadre deviennent hypnotiques. Même si le rendu de l’image en DVD est tout à fait satisfaisant, on peut penser que cette lenteur et ce travail plastique épuré se prêtent plus au cinéma qu’à la télévision.
L’apport majeur du DVD se trouve ici dans la section suppléments puisqu’un second film d’Albert Serra, inédit en salles en France est proposé, Le seigneur a fait pour moi des merveilles. L’objet est déconcertant : à la frontière du documentaire et d’une fiction minimaliste, le film porte la marque du cinéaste. Des plans très longs et un travail assez recherché sur certains cadrages titillent l’imagination du spectateur. Mais le caractère abscons de certaines conversations et l’ensemble, qui s’appréhende avec une certaine difficulté, laissent parfois de côté. Et pourtant, la fin, illustrée par Try to Remember de Harry Belafonte, nous rattrape in extremis, laissant un souvenir flottant, à l’image de ce film à l’atmosphère douce et lancinante.
François-Xavier Taboni








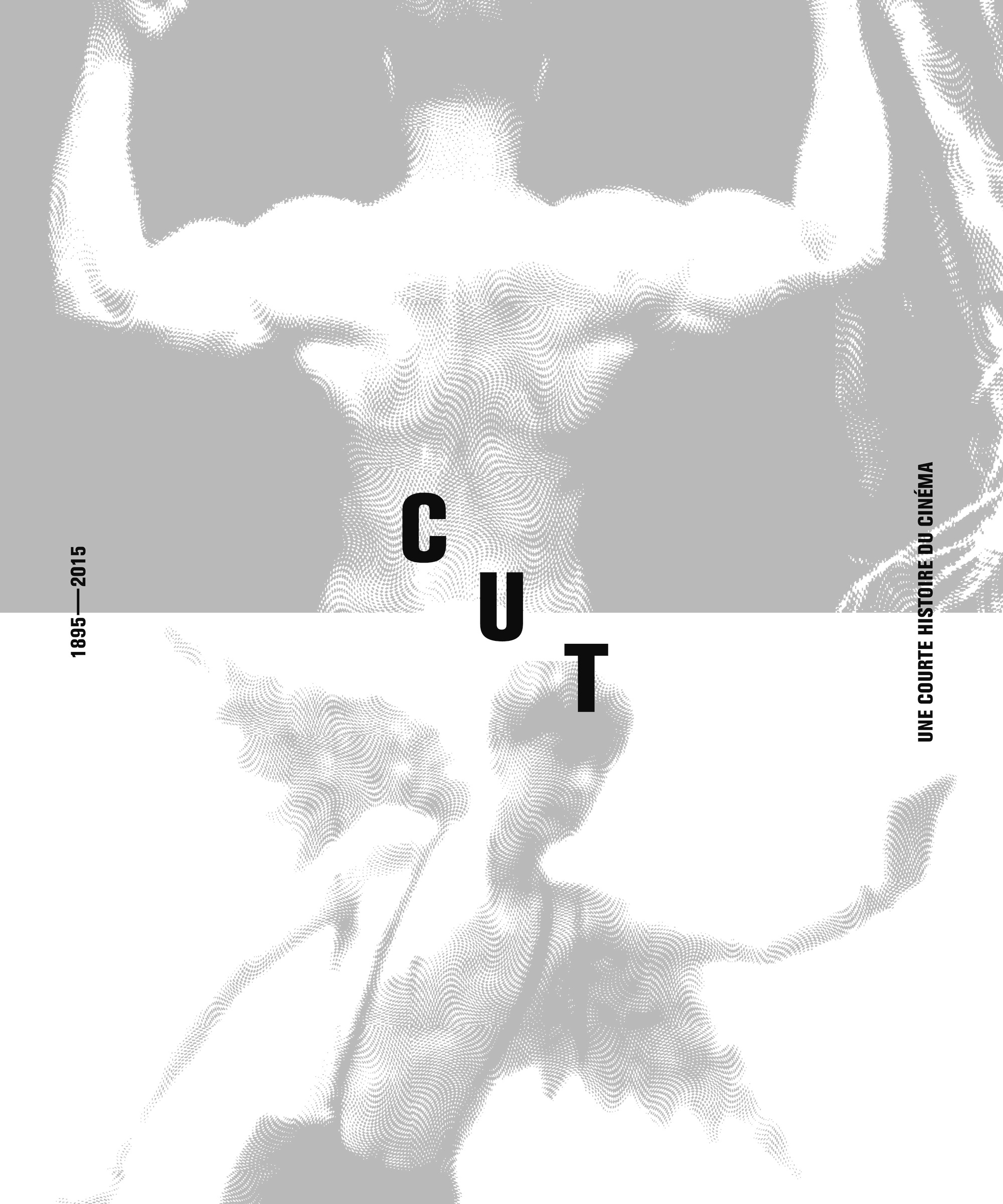



Commentaires récents